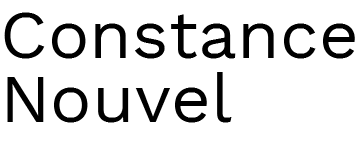Un théâtre d’indices
Victor Mazière, 2016.
Depuis son invention au XIXème siècle, la photographie a progressivement transformé nos sensibilités, jusqu’à s’imposer, au cours de la période post-moderne, comme un modèle conceptuel pour la plupart des stratégies déployées dans les arts visuels : car très tôt, la découverte du procédé photographique, nourrie d’un contexte où se mêlaient le positivisme, le spiritisme et la révolution industrielle, s’accompagna d’une réflexion théorique visant à éclairer la pratique expérimentale. Pour les pionniers de la photographie, et en premier lieu pour Nadar, l’empreinte photographique fut ainsi très vite envisagée comme un indice, c’est-à-dire comme une marque signifiante dont le lien avec l’objet représenté est d’avoir été physiquement produit par son référent. Néanmoins, au XIXème siècle, l’indice n’avait pas le sens que lui donnera plus tard la sémiologie : en effet, la trace photographique, à cette époque, n’était considérée ni comme un signe, ni comme l’empreinte d’un l’objet qui aurait été simplement prélevée dans le tissu de la réalité puis déposée ensuite sur une autre surface. C’était la matérialité-même de l’objet devenue intelligible : ce qui explique peut-être que, dans ce mode éminemment technologique de production d’images, se soient greffés tant de fantasmes proto-scientifiques, puisque l’image photographique, dans la logique et la philosophie de l’époque, participait à la fois d’une matérialité absolue et d’une intelligibilité métaphysique pleinement réalisée dans la forme du document (1).
C’est avec le développement de la sémiotique, et tout particulièrement grâce aux théories de Peirce (2), puis aux études décisives de Rosalind Krauss sur Duchamp et les Surréalistes (3), que le signe photographique put acquérir une ontologie spécifique, dégagée des systèmes de représentation iconique ou symbolique d’une part, et de l’idée d’une « vérité » de l’image d’autre part. Charles Sanders Peirce considérait ainsi les images photographiques, dans sa taxinomie des signes, comme des indices, au sens que nous donnons aujourd’hui au terme : « les photographies, écrivait-il, sont très instructives parce que nous savons qu’à certains égards elles ressemblent exactement aux objets qu’elles représentent. Mais cette ressemblance est due aux photographies qui ont été produites dans des circonstances telles qu’elles étaient physiquement forcées de correspondre point par point à la nature. De ce point de vue, elles appartiennent à la seconde classe de signes ; les signes de connexion physique »(4), c’est-à-dire les indices. Notons au passage que, pour Peirce, le mouvement d’une girouette agitée par le vent est également un indice : ce qui distingue l’indice de l’icône provient en effet du fait que l’icône est simplement lié à son référent par la ressemblance physique, qui peut très bien être produite par l’imagination, comme dans le cas de la peinture, alors que l’indice nécessite une corrélation physique au référent, antérieure à toute forme de ressemblance ou de convention symbolique, et peut, par conséquent, très bien ne pas ressembler à ce qui l’a produit. Les distinctions qu’établit Peirce se situent donc dans le processus génésique de l’empreinte : qu’elle soit engendrée par la rencontre de la lumière sur une surface photosensible ou sur des capteurs numériques, une photographie, même floue, ou illisible, est toujours indicielle. La ressemblance, quant à elle, est « physiquement forcée ». C’est-à-dire aussi que, dans son mode de configuration ou de réception, une image indicielle peut être délibérément envisagée pour ses qualités secondes, c’est-à-dire pour son inscription dans un système iconique (la ressemblance) ou symbolique (les connotations culturelles, par exemple), et non pour ses seules qualités premières.
Quel que soit donc, au-delà de son ontologie, le dépli sensible d’une photographie et son inscription dans une stratégie perceptive, il semble indéniable que le champ esthétique, avec le déplacement introduit par l’empreinte, de la fonction iconique (d’ordinaire reservée à la peinture), vers la fonction pré-symbolique et pré-figurale du signe indiciel, désarticula d’une certaine façon l’axe signifiant : non au sens où, avec l’abandon de l’idée d’une relation d’adéquation sémiotique essentielle de l’objet au signe, toute forme de relation sémantique fut supprimée au profit d’un processus de captation purement physique, mais au sens où la fonction iconique ou symbolique conventionnelle fut court-circuitée, « convulsée »(5) par l’indice ; d’où ce fantasme, parcourant la post-modernité depuis Duchamp, et rendu soudainement possible par le paradigme photographique, de pouvoir extraire l’objet de son système d’interprétation traditionnel (incarné par le ready-made et sa fonction d’usage) etde ledéplacer simultanément vers une double topologie : celle de l’espace de l’exposition et celle de la signification. Comme si définir le territoire d’une relation spatiale était l’équivalent de délimiter l’espace d’une relation sémantique : aussi la post-modernité, loin d’avoir été une simple dépréciation ironique de l’art, se dut d’être iconoclaste afin de briser l’iconolâtrie. Car ne s’est-il pas agi, au fond, de rompre avec l’illusion réaliste, avec le dogme de la véracité de l’archive pour atteindre l’absence sémantique et l’immatérialité du signe à travers la matérialité-même de l’objet? comme deux règnes s’excluant mutuellement mais dépendant l’un de l’autre : et n’est-ce pas aussi ce qui advient lorsqu’un objet passe de l’existence physique à celle du signe photographique?
Car ce mode de production d’images, sans doute le plus matériel et physique qui soit, est aussi celui où la trace révèle dans sa plus grande évidence la fonction de supplémentation du signe, qui vient prendre la place de l’objet et ne pourra exister comme signe que parce que l’objet est absent. Toute image de la réalité est donc spectrale : peut-être même, dans la mesure où nous n’avons jamais du réel qu’une image, ce que nous nommons réalité n’est en fait que le visage phénoménal de la spectralité ; or si un spectre est une visibilité invisible, une forme informe changeant de configuration au gré des « luminances »(6), qui la porte vers l’ apparaître et donc vers l’image, alors le fait qu’une image soit une image déterminée est au fond, quant à son ontologie, secondaire, contingent. C’est-à-dire aussi que, paradoxalement, pour la photographie, l’image est essentiellement vide, elle est comme le signe spectral manifestant l’essence contingente de la réalité, son écriture blanche et sa réserve figurale : ou pour le dire autrement, l’empreinte photographique, ontologiquement, s’incarnera toujours dans une forme spécifique, celle d’un moment déterminé, mais derrière cette surface, sous cet horizon, s’étendra toujours l’origine invisible de toute image, l’image manquante, première, toujours-déjà occultée par le signe dont elle est l’image seconde ; et cet obscur objet du désir, ontologiquement retiré en lui- même, alimentera peut-être toujours la soif éternellement insatisfaite du regard, ainsi que son mal d’archive.
Nous sommes ainsi peut-être arrivés à un moment, où la photographie, désormais dans sa post -histoire peut faire retour sur elle-même, comme pour explorer à nouveau son ontologie en se confrontant également à sa mythologie. Dans ce double mouvement, Constance Nouvel remet ainsi en perspective, à travers ses expérimentations, les incertitudes qui ont traversé la photographie, et qui tiennent peut-être à la nature complexe de ce type d’empreinte, à la fois métaphysique (son lien avec l’apparaître des choses, leur venue au monde) et technologique (son lien avec une scientifisation de la réalité) : en méta-photographe d’une post-histoire de la photographie, son premier geste sera donc celui de laisser revenir à elle les fantômes.
Son travail commença d’ailleurs par l’exploration de la sédimentation de l’image, par sa géologie. Comme s’il fallait fouiller dans le corps de l’empreinte pour en atteindre l’origine invisible. La série Une perception en strates montrait ainsi des photographies littéralement creusées, mettant en scène l’idée d’une rupture de l’épiderme de l’image, ouvrant, dans le fendillement de la surface, vers sa temporalité sédimentée, la tectonique des histoires non révélées qui se seraient pourtant déposées en elle : geste de déconstruction de l’ontologie des images, qui renvoie à ce qui s’étend sous la planéité de son horizon, dans la pliure de son arrière-monde, évoquant aussi au passage l’incomplétude de toute archive. Croissant depuis un terreau sans fond, la matière de l’image photographique est cet agrégat fragile où le temps, la lumière et l’objet se sont rencontrés à un moment, pour s’incarner dans une image et une seule, mais qui, pourtant, porterait dans son épaisseur foliée toutes les variations possibles, comme les pages effacées d’un livre à venir, pourtant toujours-déjà écrit. Nous pensons ici à l’étrange « Théorie des spectres » de Balzac, auquel Nadar fait d’ailleurs référence dans son livre : « Donc, écrivait-il, selon Balzac, chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en pellicules infinitésimales dans tous les sens où l’optique perçoit ce corps. Chaque opération daguérienne venait donc surprendre, détachait et retenait en se l’appliquant une des couches du corps objecté »(7). Pour Balzac, la photographie détache matériellement une couche de la réalité, puisque rien ne naît ex-nihilo ; Constance Nouvel, quant à elle, si elle dialogue, en un certain sens, avec cette origine mythologique de la photographie, le fait ici dans le langage de la sémiotique : en déconstruisant le feuilletage de la stratification indicielle, elle explore conceptuellement le tissu sous-cutané et spectral de l’image ; le spectre n’a pas ici le sens étrangement matérialiste-spiritualiste de Balzac, si représentatif du croisement de scientisme et de spiritisme que l’on trouve chez Swendenborg, mais celui d’une source manquant à tout système signifiant, d’une inconnue, par essence invisible et dépourvue de sens, fondant la mécanique différentielle de la sémantique et la rupture à soi du référent et du signe. Pages par ailleurs permutables à l’infini, comme le sont les ciels interchangeables, les océans, les paysages de ses photographies, figures de l’infinie mouvance de l’océan des formes, où chaque vague, distincte de l’autre, lui est pourtant semblable. Où nous ne pouvons au fond plus vraiment distinguer ce qui est artificiel de ce qui est naturel, puisque les deux catégories s’abolissent dans le scintillement signifiant de l’indice : comme un abandon du langage, dans les sensations mémorielles-tactiles du bleu un peu trop bleu de ses images, des espaces un peu trop ordonnés, qui se confrontent alors à nos propres archétypes, à nos constructions artificielles où, en architecturant un espace physique, nous construisons aussi un espace mental. Et inversement : puisque nos souvenirs sont eux aussi toujours-déjà ceux des architectoniques que nos yeux ont emmagasiné sans les voir. En cela, le punctum barthésien, même s’il peut parfois s’y cacher, n’est pas réellement ce qui constitue le terrain d’exploration de Constance Nouvel, ni l’instant décisif, mais plutôt la plasticité de la matérialité de l’image, sa trouée, et sa capacité à moduler un espace de représentation.
Le rôle de la grille est sans doute ici décisif dans le passage de la narration vers l’anti-récit : superposée à des images sans qualités, de l’ordre de ces cartes postales que nous avons toujours-déjà vues ou de ces souvenirs d’images, à la fois inlocalisables et sur-déterminées, et donc contingentes, la grille s’affranchit ici de sa fonction de matrice perspectiviste-narrative, qui est typique de la représentation iconique, pour devenir le labyrinthe d’une forme signifiante dégagée de toute histoire et de tout système symbolique. Si l’allusion à la perspective demeure dans son travail, elle est, alors, dans le hors champ de l’image, dans ses marges, l’encadrant tout en préservant l’espace autonome de la représentation. Il est d’ailleurs ici remarquable que l’usage de la grille aboutisse à un effet d’émancipation, conceptuellement assez similaire à celui qu’il eût dans l’art moderne : c’est-à-dire celui de délivrer par une forme neutre et répétitive l’espace du tableau de la représentation, en lui conférant ainsi une existence de signe pur, autonormé par le mythe fondateur d’une rupture historique et d’un anti-développement. Là où peut-être se situe l’écart tient au fait que Constance Nouvel ne cherche pas la saisie purement phénoménologique : la grille joue le rôle, non d’un aplatissement ontologique de l’espace dans sa bidimensionnalité et sa forme pleinement réalisée, mais d’un élan vers un autre medium, en l’occurence la sculpture : répondant, comme dans un chiasme, à la plongée dans les soubassement de l’image, la grille est ici ce qui croît dans l’autre verticalité, celle qui part de la surface vers l’espace accessible au regard. En cela, l’image plate, horizontale, neutre est une interface entre ce qui naît ou se retire dans l’ontologie des profondeurs invisibles, et ce qui s’élance hors de l’image, dans le monde phénoménal. La relation que Constance Nouvel entretient à l’indice est donc celle d’un champ étendu vers deux axes verticaux, l’un rencontrant la sculpture interne du temps, et l’autre la sculpture externe de la forme, non seulement physique, mais mentale, au-delà de l’image. Il n’est donc pas étonnant qu’elle combine ses images à des volumes, que l’on peut d’ailleurs tenir dans une main ; ou encore que dans l’espace de l’exposition, elle ménage des trouées qui sont comme des ouvertures vers l’espace au-delà de la perception : trouées des fausses fenêtres qui ne sont plus, comme dans le cas d’Alberti, des grilles perspectivistes ; faux horizons reconstitués dans l’espace de toute une pièce, et ouvert sur un second horizon, décalant ainsi la perception vers un jeu d’intervalles spatiaux et conceptuels. On pourrait ici parler de théâtralité, dans le sens où, pour Michael Fried, il est ce qui « se tient entre les arts »(8). Dans le cas précis de la relation existant entre le théâtre et la forme sculpturale, l’analyse de Fried porte sur la notion de temps : c’est la temporalité étendue vers le champ de l’espace, une fusion de l’expérience temporelle de la sculpture avec le temps réel, qui pousse les arts plastiques vers la théâtralité (à la différence pour lui, justement, de la peinture moderne, expérimentant une pure présence qui neutralise ainsi toute théâtralité). Il s’agirait donc finalement, dans le travail de Constance Nouvel, de faire se recouper deux champs : celui de l’indice photographique, de l’indicialité étendue dans le champ de l’installation post-moderne, et celui de la théâtralité. Dans l’espace de ses expositions, Constance Nouvel confronte ainsi sans cesse les conventions formelles afin de créer des intervalles signifiants, des espacements, où la fonction indicielle étendue à la totalité du champ perceptif, redistribue les chemins signifiants au fil du parcours de l’oeil : dans le théâtre trans-historique qui se forme alors peuvent se côtoyer un papier peint représentant une peinture, directement collé sur le mur et une photographie abstraite, montrant un grain élargi jusqu’à ce que la réalité se perde, dans une surface rouge comme une lumière primitive qui alimenterait toute photographie, rouge comme sa glaise première d’où toute forme provient. Par un raccourci étonnant, le regard passe sans transition de la réalité représentée jusqu’à sa disparition dans la limite de ce que l’empreinte enregistre. Nous pensons ici à Blow-Up (9), à cette scène de l’grandissement où la réalité finit par se perdre dans l’atomisation de sa matière, élargie jusqu’à n’être plus qu’un brouillard quantique, inaccessible à toute optique : car si toute photographie est, au fond, une scène de crime sans victime, où la mort à l’oeuvre a retranché irrémédiablement une parcelle de son tissu à la réalité, elle est aussi une terre adamique, où croissent sans cesse de nouveaux signes, comme un règne, autonome, spectral, au sein de la réalité. Ne serait-ce pas au fond dans cet hyper-feu plus noir que la nuit, dans cette lave originelle, que toute photographie rêve de plonger : à nouveau, pour la première fois?
- Rosalind Krauss, Le Photographique : pour une théorie des écarts, Editions Macula, Paris, 1990, ch « Sur les traces de Nadar » pp. 18-35
- Charles Sanders Peirce, Ecrits sur le signe, 1978, Seuil, Paris, 1978
- Rosalind Krauss, op. cit., « Marcel Duchamp ou le champ imaginaire », pp. 71-88 et « Photographie et surréalisme », pp. 100-124
- Rosalind Krauss, op. cit., « Marcel Duchamp ou le champ imaginaire », p. 77
- Nous empruntons l’expression « convulsée par l’indice » à Rosalind Krauss.
- Nous empruntons le terme de luminance à Roland Barthes, cf Roland Barthes, La Chambre claire, Gallimard-Seuil, 1997, p. 126-127 : « La chose d’autrefois par ses radiations immédiates (ses luminances) a réellement touché la surface qu’à son tour mon regard vient toucher »
- Rosalind Krauss, op. cit., p. 21
- Michael Fried, « Art and Objecthood », 1967, Artforum V, p.31
- Michelangelo Antonioni, Blow Up, 1966